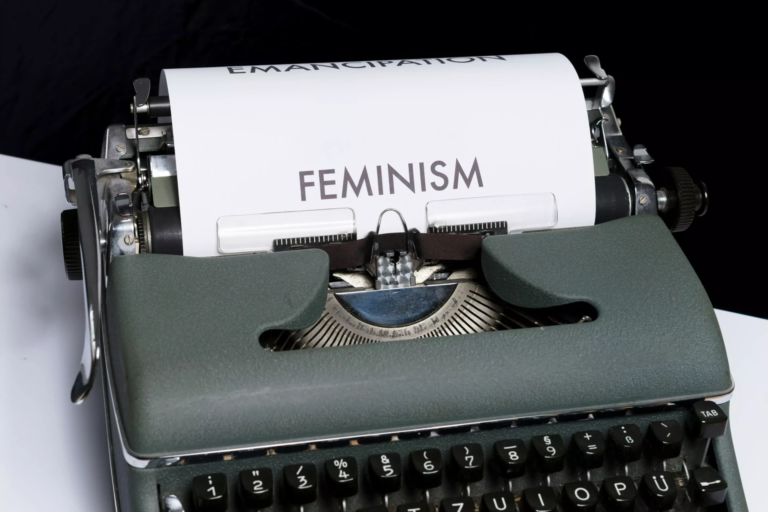Nous y sommes, en terrain miné – du moins en apparence. Féminisme : un mot pluriel qui englobe en réalité des féminismes mais aussi des idées reçues, parfois franchement péjoratives. Parce qu’il a été caricaturé, réduit à des images négatives, ou confondu avec un renversement de domination, le féminisme nécessite d’être redéfinit. Parce que ce terme, les idées et revendications qu’elles sous-tend nous concerne tous et toutes, et vise bien l’égalité, non la supériorité.
Le féminisme suscite à la fois l’espoir, la controverse et l’incompréhension. Il fait partie du langage courant, tout en demeurant flou pour beaucoup. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque le féminisme ? Est-ce une idéologie, un combat, une revendication, une insulte ? Faisons le point.
Une définition du féminisme
Le féminisme désigne l’ensemble des idées, mouvements et luttes qui visent à mettre fin aux inégalités entre les genres et à défendre les droits des femmes. Il ne s’agit pas d’une haine des hommes, ni d’un désir de domination, mais d’un engagement pour l’égalité réelle. Ce terme regroupe des pensées diverses mais unies par une volonté commune : en finir avec les rapports de domination fondés sur le genre.
Cette lutte se décline selon les époques et les contextes culturels. Elle peut concerner le droit de vote, l’accès à l’éducation, la liberté sexuelle, la dénonciation des violences, ou encore la place des femmes dans le monde professionnel ou artistique. Le féminisme évolue avec la société.
Un mouvement historique et multiple
Dès le XVIIIe siècle, des femmes ont revendiqué le droit à l’instruction, à l’expression et à la citoyenneté. Au fil des siècles, les combats se sont organisés, structurés en vagues, avec des revendications différentes selon les périodes. Le féminisme s’est enrichi de voix variées : blanches et racisées, bourgeoises et populaires, cisgenres et transgenres, hétérosexuelles et LGBTQIA+.
Cette diversité reflète une prise de conscience essentielle : toutes les femmes ne vivent pas les mêmes formes d’oppression, et les luttes féministes doivent s’ajuster aux réalités spécifiques de chacune.
Pourquoi le féminisme dérange ?
Nombreuses sont les critiques qui accusent le féminisme d’exagération, de division ou de radicalité. Ces réactions traduisent souvent une incompréhension de son objectif : interroger des systèmes profondément ancrés, remettre en cause des privilèges, visibiliser des violences ou des exclusions qui passent pour normales.
Le féminisme ne se contente pas de réclamer des droits : il propose un autre regard sur la société, sur les rapports humains, sur les récits dominants. Il interroge la manière dont les normes de genre façonnent nos vies, nos choix, nos libertés. Et cette remise en question peut, à juste titre, déranger.
Des inégalités encore bien réelles
Dire que le féminisme est encore utile, c’est rappeler que les inégalités persistent. Les violences sexistes et sexuelles touchent encore un grand nombre de femmes, tout comme le sexisme ordinaire qui s’exprime dans les conversations, les médias ou au travail. Les écarts de salaires restent une réalité, tout comme la sous-représentation des femmes dans les instances de pouvoir, qu’il s’agisse de la politique, des grandes entreprises ou de la recherche scientifique. La précarité touche plus fortement les femmes, en particulier les mères isolées et celles qui occupent des emplois à temps partiel imposés. À cela s’ajoute le poids de la charge mentale, invisible mais écrasante, qui continue de faire peser sur elles la responsabilité quasi exclusive de l’organisation domestique et familiale.
Ces enjeux ne se limitent pas à des inégalités visibles. Le manque de représentations féminines dans les arts, la culture ou le sport contribue aussi à renforcer des modèles de genre figés. S’y ajoutent la charge mentale, c’est-à-dire le poids invisible de l’organisation domestique, ou encore le « gender pain gap », cette tendance à minimiser la douleur des femmes dans le domaine médical. Ces réalités montrent que l’égalité reste à conquérir dans les faits, même lorsque les textes de loi proclament le contraire.
Un combat qui nous concerne toutes et tous
Le féminisme n’est pas une affaire du passé. Il est vivant, multiple, en mouvement. Il accompagne des prises de conscience individuelles et collectives, éclaire des discriminations croisées — par exemple, celles qui touchent les femmes racisées, handicapées ou issues de milieux populaires. Il offre des outils pour comprendre, pour questionner et pour transformer.
En ce sens, le féminisme ne s’adresse pas seulement aux femmes mais à toute la société : chacun et chacune a à gagner dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus libre.